L’éducation, première politique publique d’une démocratie réelle
- Sandie Carissan
- 17 mai 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 9 juil. 2025

En 1833, François Guizot faisait voter une loi sur l’instruction primaire. Pour cet intellectuel libéral du XIXe siècle, l’avenir de la démocratie passait par l’éducation, la raison, et la culture. Deux siècles plus tard, alors que notre attention est captée par les écrans et que l’intelligence artificielle s’immisce dans nos vies quotidiennes, cette vision humaniste de la politique publique semble en déclin. C’est à ce grand écart qu’a voulu s’attaquer la conférence « De Guizot à ChatGPT : où en est la politique de l’esprit ? », par l’historien et sociologue Jean-Miguel Pire et l'historien Jacques de Saint Victor, ce vendredi 16 mai à Conscious Paris.
Une politique de l’esprit née des Lumières
La « politique de l’esprit », expression reprise à Paul Valéry, désigne un idéal dans lequel la puissance publique promeut activement l’émancipation intellectuelle des citoyens : instruction populaire, valorisation des arts, promotion des sciences et de la raison. En cela, Guizot, ministre de l’Instruction publique sous la monarchie de Juillet (1830-1848), fut un pionnier.
Son projet ? Éduquer le peuple non pour le contrôler, mais pour l’élever .
« Moins on est éclairé, moins on ressent le besoin de lumière ». Guizot
La loi de 1833 impose une école primaire dans chaque commune : elle est la première pierre de ce qui deviendra, cinquante ans plus tard, l’école républicaine de Jules Ferry.
L’éducation comme fondement de la liberté
Guizot croyait en une démocratie fondée sur l’instruction. Pour lui, la citoyenneté ne peut être réelle sans formation intellectuelle : lire, écrire, raisonner sont des conditions de la liberté politique. Guizot considérait que le droit de vote devait être accordé à des citoyens éduqués, capables de réfléchir, de lire la presse, de comparer les idées. Pour lui, la démocratie exige des citoyens éclairés, sinon elle devient vulnérable.
Deux dérives menaçaient une démocratie sans instruction :
Le populisme : une stratégie politique qui prétend parler « au nom du peuple » contre « les élites », en utilisant des discours simplistes, émotionnels, souvent mensongers. Les populistes exploitent la colère, désignent des ennemis faciles, et promettent des solutions magiques à des problèmes complexes.
L’autoritarisme: un régime où le pouvoir se concentre entre les mains d’un seul ou d’un petit groupe, au détriment des libertés. Un peuple mal informé peut, par son vote, élire un dirigeant qui supprimera ensuite la démocratie
Du progrès éducatif au recul culturel ?
Aujourd’hui, cet héritage est-il encore vivant ? Et bien... selon les conférenciers l’idéal guizotien s’est effrité sous les coups de plusieurs mutations : crise de l’école, appauvrissement des politiques culturelles, montée du divertissement de masse, désengagement de l’État dans le champ intellectuel.
La culture a cédé du terrain à l’« entertainment », et la raison au règne des émotions. Pire encore : dans un monde saturé de récits, la vérité elle-même semble avoir perdu de sa force. Dans l’ère de la « post-vérité »*, ce n’est plus ce qui est vrai qui compte, mais ce qui est séduisant. Résultat ? Une démocratie fragile, où l’ignorance devient parfois respectable, et l’effort intellectuel perçu comme une contrainte.
*Dans une démocratie saine, on prend des décisions en s’appuyant sur des faits, des preuves, la raison. En régime de post-vérité, ce sont les récits séduisants, les émotions fortes, ou même les mensonges répétés qui l’emportent.
Ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux, où chacun peut diffuser n’importe quelle information, sans vérification.
Intelligence artificielle, réseaux : quel usage de l’intelligence ?
L’irruption de l’intelligence artificielle, symbolisée par des outils comme ChatGPT, relance le débat. Est-elle une opportunité pour la diffusion du savoir ou un nouveau facteur d’abrutissement ? Tout dépend de l’usage. Mais Jean-Miguel Pire alerte : si l’IA dispense les étudiants de l’effort de pensée, si elle devient une béquille à la place d’un outil, elle déstructure ce que Guizot valorisait le plus : le chemin de la connaissance, plus que son résultat.
C’est là l’un des "drames" contemporains : une société qui a accès à tout, immédiatement, mais sans cadre, sans filtre, sans formation à l’esprit critique.
Or, l’intelligence n’est pas un produit ; c’est une conquête.
L’État en retrait face au marché de l’attention
L’autre grand changement, plus structurel, concerne le rôle de l’État. Celui-ci, acteur central de la politique de l’esprit au XIXe siècle, a vu sa place reculer. À partir des années 1980, selon les intervenants, les politiques culturelles ont pactisé avec les industries du divertissement. Le ministère de la Culture s’est transformé en opérateur d’événements, la culture s’est vue assimilée à un produit de consommation.
Selon J-M Pire, face aux géants du numérique, l’État paraît dépassé. Il distribue des chèques culture, pour encourager la consommation de biens culturels, mais sans distinction. On peut acheter un roman classique ou une place de cinéma léger : tout est mis au même niveau. Cela revient à dire qu’un livre vaut une série, ou qu’une opinion vaut un savoir. Ce mélange affaiblit l’idée même de culture comme outil d’émancipation.
Repenser une politique de l’émancipation
Alors, que reste-t-il de la « politique de l’esprit » ? La conférence appelle à un sursaut politique et éducatif. L’école, l’université, la recherche, les arts doivent redevenir des priorités nationales. Non pour produire des diplômés rentables, mais pour former des citoyens libres. Comme le disait Guizot, il ne s’agit pas seulement d’instruire, mais d’éduquer au discernement, à la pensée, à la liberté.
Cela suppose de revaloriser l’effort intellectuel, de remettre la lecture, l’histoire, la philosophie au cœur du cursus.
Si nous ne voulons pas que la démocratie devienne une simple façade, nous devons assumer que l’intelligence est un bien commun, et que l’éducation de l’esprit est la première des politiques publiques.
______
Le livre de Jean-Miguel Pire (que je n'ai pas encore lu) s'intitule "Guizot, la politique de l'esprit".
Avec en exposition lors de la conference à Conscious Paris 12 rue de Normandie, les tableaux de Véronique Masurel.



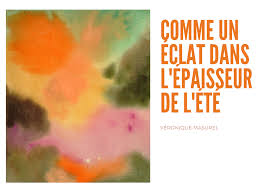





Commentaires