La société de la fatigue
- Sandie Carissan
- 13 août 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 août 2025

Je souhaite vous partager ici le résumé du livre "La société de la fatigue"de Byung-Chul Han (que j'adooOoOore) chapitre par chapitre. Je trouve important de partager les réflexions centrales de ce livre car il présente un malaise que beaucoup ressentent sans toujours savoir l’expliquer. Il montre comment notre époque a remplacé les contraintes visibles d’hier par une pression intérieure plus insidieuse : l’injonction permanente à se dépasser, à rester productif, à être " positif " en toutes circonstances. Sous couvert de liberté et d’autonomie, nous devenons nos propres surveillants, travaillant sans relâche à optimiser notre corps, notre esprit et notre image, jusqu’à l’épuisement.
Ce livre permet de comprendre que le burnout, l’anxiété chronique ou la sensation de ne jamais en faire assez ne sont pas seulement des expériences individuelles : ils sont les symptômes d’un système qui a fait de la performance un mode de vie. Le lire, c’est mettre en lumière ces mécanismes invisibles, reconnaître que l’épuisement n’est pas une faiblesse personnelle, mais une conséquence sociale et culturelle.
Il offre un langage pour décrire ce que nous vivons, ouvre la voie à une réflexion collective sur le repos, la liberté et la valeur réelle de notre temps, et nous donne les clés pour repenser notre rapport au travail, à nous-mêmes et aux autres.
Bonne découverte !
Chapitre 1. Le paradoxe de la liberté
Han retrace le passage des sociétés disciplinaires (où la contrainte vient de l’extérieur : règles, surveillance) vers la société de la performance, où la pression s’intériorise. On se vit comme “entrepreneur de soi”, libre en apparence, mais sommé d’auto-optimiser sans fin. Cette liberté devient un outil d’auto-exploitation : l’échec est imputé à l’individu, jamais au système, d’où un terrain propice au burnout et à l’épuisement existentiel. Le paradoxe central : plus de liberté formelle, moins de liberté réelle, car la norme de surperformance envahit l’intime.
Chapitre 2. L’hyperactivité comme norme
L’ère numérique dissout la frontière travail/loisirs/repos : notifications permanentes, disponibilité attendue, flux sans pause. La valeur sociale de "l’occupé” transforme le temps libre en faute morale. Résultat : stress chronique, anxiété, sentiment d’insuffisance et chute de l’estime de soi, l’esprit étant maintenu en régime d’alerte continu, un milieu idéal pour l’épuisement.
Chapitre 3. La tyrannie de la positivité
S’impose une obligation de bonne humeur et d’"énergie” : doute, fatigue ou tristesse deviennent des anomalies à cacher. La positivité de commande se marie au culte de l’auto-optimisation : optimiser sa santé, ses loisirs, son sommeil : même le "care” se convertit en tâche mesurable. Cette injonction à aller "toujours mieux” aplatit la vie émotionnelle, nourrit dépression et anxiété, et convertit chaque baisse de régime en faute personnelle.
Chapitre 4. L’épuisement de soi
Dans la société de la performance, chacun devient à la fois manager et managé de soi. Les indicateurs (likes, métriques pro, trackers) installent une auto-surveillance sans fin. Cette logique mène au burnout : pas simple fatigue, mais usure du sens, érosion de la compassion envers soi, et rendements décroissants malgré l’effort accru. La prétendue liberté se renverse en autotyrannie sous l’impératif "sois performant”.
Chapitre 5. La disparition du repos mental
Han montre comment l’action perpétuelle évince la contemplation : plus d’espace pour la lenteur, la marche, la lecture réfléchie. L’hyperconnexion colonise l’entre-deux, empêchant la récupération cognitive. Privé de ces vides nécessaires, l’esprit sature : fatigue attentionnelle, créativité en berne, vulnérabilité accrue au burnout. Han plaide pour réhabiliter des pratiques de pleine conscience et des coupures digitales intentionnelles.
Chapitre 6. Les nouveaux régimes de travail
Les plateformes, le télétravail et l’“ubérisation” offrent une flexibilité d’organisation, mais au prix d’une plus grande instabilité : revenus variables, protections sociales réduites, dépendance aux évaluations et aux algorithmes.
Cette liberté apparente s’accompagne souvent d’une disponibilité permanente et d’une frontière floue entre vie professionnelle et vie personnelle. Le travail déborde sur les soirées, week-ends et vacances, maintenant un état d’alerte qui complique la déconnexion et accroît le risque d’épuisement, malgré quelques gains ponctuels d’autonomie.
Chapitre 7. Repenser liberté et repos
Sortir de la spirale suppose de redéfinir la liberté : non comme pouvoir de produire plus, mais comme capacité de dire non, de se soustraire à l’injonction de performance. Han défend le “temps inopérant” (sans finalité utilitaire) : conditions de gratuité, jeu, contemplation, qui restaurent la santé psychique. À l’échelle collective : revaloriser le repos comme bien commun, réviser nos critères de succès, et bâtir des communautés qui reconnaissent la valeur des personnes au-delà de leurs résultats.
Alors ? Vous en pensez quoi ?
_____________
Han, B.-C. (2024). La société de la fatigue (J.-L. Schlegel, Trad.). Paris : Presses universitaires de France.
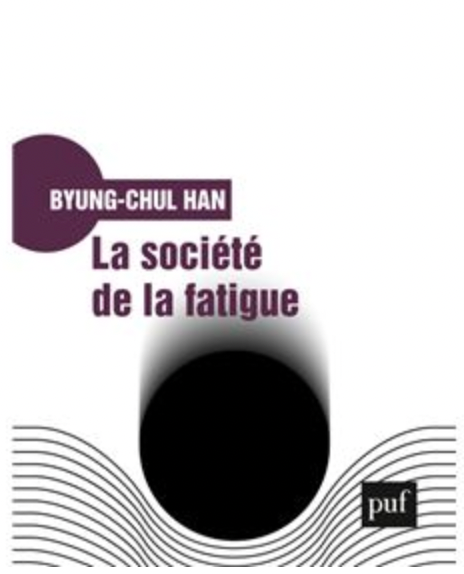




Commentaires